En finir avec le Tripalium !
Tripalium, ou Tripliare, même le fameux Chat GPT, cette intelligence artificielle qui effraie les enseignants, reproduit encore ces rengaines ignorantes. A désespérer de l’intelligence. Ou au contraire, réjouissons-nous, l’IA Chat GPT est pour l’instant aussi routinière que ses concepteurs. Non, l’étymologie du mot « travail » ne vient pas du latin tripalium ou tripaliare, la soi-disant torture.
Travailler : Tripalium 0 / Travel 1
Pour débarrasser le mot « travail » de cette fausse étymologie qui le poursuit, il faut justement prendre l’étymologie au sérieux. Que dit-elle ? C’est linguistiquement une aberration de voir le mot tripalium comme origine du mot « travail », et donc une erreur de perspective pour la pensée. Citons simplement et principalement George Gibb Nicholson, linguiste australien, philologue et professeur de français, qui en 1927 a publié un article intitulé : « Français travailler, travail »1. Pour aller vite, en évolution linguistique et phonétique, un "i" n’évolue pas en "a", comme un "p" ne devient pas "v". Au dire des spécialistes, ce serait une évolution contre nature. Le provençal trebalh, l’espagnol trabalo, le portugais trabalho, et le français « travail » ne font entendre ni "i", ni "p".
Or, le mot « travail » existe depuis fort longtemps. C’est notamment la trabicula latine qui désigne une « poutre », un « catafalque » ainsi qu’une « machine de maréchal » (travaglio en italien), soit un outil en bois pour soutenir une structure, ou le pied d’un cheval que l’on doit ferrer. Nous avons bien phonétiquement le « a » et le « b/v ». Et l’on retrouve le mot « traverse », cette poutre qui consolide, et dont le son nous rappelle que l’anglais a pris ce mot devenant trave et, vogue la galère, leur travel a suivi ! Le travail a finalement un goût de voyage, un moyen de traverser, d’aller plus loin.
Or, le mot « travail » existe depuis fort longtemps. C’est notamment la trabicula latine qui désigne une « poutre », un « catafalque » ainsi qu’une « machine de maréchal » (travaglio en italien), soit un outil en bois pour soutenir une structure, ou le pied d’un cheval que l’on doit ferrer. Nous avons bien phonétiquement le « a » et le « b/v ». Et l’on retrouve le mot « traverse », cette poutre qui consolide, et dont le son nous rappelle que l’anglais a pris ce mot devenant trave et, vogue la galère, leur travel a suivi ! Le travail a finalement un goût de voyage, un moyen de traverser, d’aller plus loin.
Le mot derrière le masque
Le supplice envolé, il reste l’essentiel : le travail est un outil, un moyen de (se) réaliser ou, plus précisément, le moyen de l’œuvre. Bien entendu, ça change tout. Toute la perspective humaine retrouve du sens et surtout, cela nous renvoie à nous même. Qu’elle est notre œuvre, personnelle ? A quelle œuvre collective participons-nous ?
Mais une « œuvre », n’est-ce pas se payer de mot pour des activités pénibles, répétitives, fatigantes, que la nécessité de gagner de l’argent pour vivre nous impose ? Qui peut véritablement choisir son travail, faire seulement ce qu’il aime ? Retour à la lutte des classes ?
La résistance à considérer positivement le travail vient de l'habitude culturelle qui veut que le travail nous serait imposé et que l'idée de supplice soit idéologiquement pratique. Au travail comme moyen d’une œuvre personnelle, l’histoire répond nécessité de vivre, contraintes sociales. C’est un peu comme si l’être humain s’était en grande partie (auto-)réduit à son utilité, un pseudo travail.
Mais une « œuvre », n’est-ce pas se payer de mot pour des activités pénibles, répétitives, fatigantes, que la nécessité de gagner de l’argent pour vivre nous impose ? Qui peut véritablement choisir son travail, faire seulement ce qu’il aime ? Retour à la lutte des classes ?
La résistance à considérer positivement le travail vient de l'habitude culturelle qui veut que le travail nous serait imposé et que l'idée de supplice soit idéologiquement pratique. Au travail comme moyen d’une œuvre personnelle, l’histoire répond nécessité de vivre, contraintes sociales. C’est un peu comme si l’être humain s’était en grande partie (auto-)réduit à son utilité, un pseudo travail.
« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ! »
Du pain et de la sueur
Biais de facilité, de rapidité, de fausse évidence ? Quand la formule est pratique, alors pourquoi hésiter : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ! » Cette assertion est devenue proverbiale, récitée bien au-delà du raisonnable par des croyants comme des non croyants. Sans doute est-ce cette citation-prétexte, détournée, mal comprise ou simplement manipulée, qui a le plus servi les discours idéologiques, moralisateurs ou autoritaires, qui a le plus servi la production-consommation. Sagesse ou mythe ancestral, d’aucuns précisent qu’il s’agit de la Genèse, donc de la Bible.
Une source malmenée
Puisque la source est connue, facile d’accès, reprenons le texte biblique. La terre est créée, Adam aussi. Dieu plante un jardin en Éden et y place l’homme. Chapitre 1 de la Genèse, verset 29, on trouve : « Dieu dit encore : “ Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. “ » La nourriture est donc donnée, il suffit de cueillir et de ramasser. Mais attention, le chapitre 2 développe et donne des détails. Verset 15 : « Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde. » Oui, au Paradis, l’homme travaille. Il développe le jardin et le protège. De la torture au Paradis ? Il s’agit de l’œuvre à continuer et préserver. Mais il y a une règle : interdiction de manger le fruit défendu de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal », la célèbre pomme.
« L’homme n’a pas été condamné à travailler, il a été condamné à produire lui-même sa nourriture. »
Au chapitre 3, arrive la dégradation que tout le monde connaît. Le serpent trompe Adam et Ève en leur faisant manger du fruit défendu. Dieu vient les voir et dit à Adam, versets 17 à 19 : « ... tu as mangé le fruit de l’arbre que je t’avais interdit de manger : maudit soit le sol à cause de toi ! C’est dans la peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. (...) C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens ; car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. »
Nous y sommes. Ce n’était pas compliqué. L’être humain travaillait, c’est-à-dire continuait l’œuvre du Jardin qui devenait aussi son œuvre, et sa nourriture était donnée. L’homme n’a pas été condamné à travailler, il a été condamné à produire lui-même sa nourriture.
Croyant ou pas, parabole, mythe, storytelling ou narratif, il faut subvenir à ses besoins : se nourrir, se vêtir, se loger, se protéger du climat, des prédateurs et des imbéciles... Mais avec tout ça, le travail ne se fait pas. « Il faut manger pour vivre » rappelle Molière, mais l’œuvre attend. Et c’est une évidence : l’être humain a - aussi - besoin de découvrir, comprendre, créer... Notre œuvre, notre jardin appelle.
Nous y sommes. Ce n’était pas compliqué. L’être humain travaillait, c’est-à-dire continuait l’œuvre du Jardin qui devenait aussi son œuvre, et sa nourriture était donnée. L’homme n’a pas été condamné à travailler, il a été condamné à produire lui-même sa nourriture.
Croyant ou pas, parabole, mythe, storytelling ou narratif, il faut subvenir à ses besoins : se nourrir, se vêtir, se loger, se protéger du climat, des prédateurs et des imbéciles... Mais avec tout ça, le travail ne se fait pas. « Il faut manger pour vivre » rappelle Molière, mais l’œuvre attend. Et c’est une évidence : l’être humain a - aussi - besoin de découvrir, comprendre, créer... Notre œuvre, notre jardin appelle.
« Ce n’est pas au travail de nous donner du sens,
c’est nous qui révélons le sens à travers notre œuvre. »
c’est nous qui révélons le sens à travers notre œuvre. »
Métaphore du Jardin, seulement ?
La structuration d’une société est de gérer les forces de cohésion / dislocation en son sein et envers les autres groupes humains. Des personnes en font même leur métier, tandis que d’autres produisent pour l’ensemble. Mais il reste que chacun a son jardin à développer. Donc renversement de la vision. Ce n’est pas au travail de nous donner du sens, c’est nous qui révélons le sens à travers notre œuvre.
Quel que soit le récit de l’origine, l’être humain a besoin de comprendre, inventer, créer. Les psy et neuroscientifiques nous disent que le cerveau humain est curieux, comme les chats d’ailleurs, et l’homme a envie de réaliser, même si cela ne sert à rien, comme faire de la peinture sur des murs de grottes, ou de la toile de lin, réaliser des choses que l’on ne peut pas manger !... L’être humain a besoin de manger et il a envie de faire autre chose.
Quel que soit le récit de l’origine, l’être humain a besoin de comprendre, inventer, créer. Les psy et neuroscientifiques nous disent que le cerveau humain est curieux, comme les chats d’ailleurs, et l’homme a envie de réaliser, même si cela ne sert à rien, comme faire de la peinture sur des murs de grottes, ou de la toile de lin, réaliser des choses que l’on ne peut pas manger !... L’être humain a besoin de manger et il a envie de faire autre chose.
« Le récit du travail est une histoire qui projette l’œuvre dans l’Histoire. »
Tout le vivant travaille...
L’oiseau qui fait son nid, le castor qui construit son barrage travaillent-ils ? Oui, certainement. Activité de production, qui plus est élaborée, complexe, qui demande du temps et de l’énergie, de la peine. Activité qui a un but, du sens : pour la protection et la vie, même si l’œuvre est éphémère. Et ils trouvent leur nourriture, donnée, dans la nature.
Comme toujours, la question est celle du sens des mots, des définitions. N’en déplaise à Emmanuel Kant pour qui l’animal ne travaille pas, l’oiseau et le castor font leurs ouvrages, qui, dans leur nature, sont leurs œuvres. Ont-ils besoin de la conscience « humaine » de travailler pour que l’activité soit qualifiée de travail ? Non. Ils ont la leur et leur travail est le moyen d’une œuvre, du moins d’un ouvrage.
Comme toujours, la question est celle du sens des mots, des définitions. N’en déplaise à Emmanuel Kant pour qui l’animal ne travaille pas, l’oiseau et le castor font leurs ouvrages, qui, dans leur nature, sont leurs œuvres. Ont-ils besoin de la conscience « humaine » de travailler pour que l’activité soit qualifiée de travail ? Non. Ils ont la leur et leur travail est le moyen d’une œuvre, du moins d’un ouvrage.
... et l’homme raconte l’histoire
La différence radicale entre l’animal et l’être humain n’est pas dans la capacité de produire, dans la technique ou encore dans la variété du travail puisque l’oiseau fait toujours le même nid. Elle est d’abord dans le fait que l’être humain peut raconter son travail. Il s’agit là des deux sens du mot « histoire » : le récit du travail est une histoire qui projette l’œuvre dans l’Histoire. L’être humain peut projeter son travail, en faire un projet dans sa propre histoire et celle des autres. Il peut penser son œuvre, « aller vers » quelque chose, c’est-à-dire avoir ou donner une direction, un sens. Sens de soi, sens du travail.
« Le supplice en revanche est de ne pas avoir de travail, ou, plus exactement, d’être empêché de faire son travail. »
Si le travail n’est pas un supplice, le supplice en revanche est de ne pas avoir de travail, ou, plus exactement, d’être empêché de faire son travail. Et c’est bien une tragédie. Le sens du mot « tragédie » signifie en effet « l’élan brisé », l’œuvre empêchée. Quoiqu’il en soi, fondamentalement, avant un emploi, nous avons besoin d’exprimer du sens par notre activité, le sens d’un travail, d’une œuvre.
Restons concret, entre cour et jardin : il est où le Jardin ?
Métro, boulot, dodo. Sans être tragique, il faut convenir qu’« Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie / Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires / De quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne / Il faut savoir ce que l'on aime / Et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones2». Pourtant, nous le savons, « que la montagne est belle... » ! Il est où le jardin ?
Le développement historique des sociétés humaines est bien sous nos yeux, du paléolithique à la 5G. Il faut travailler : avoir un métier, un emploi, un poste..., de quoi gagner de l’argent pour vivre. On trouve ainsi des équilibres ou des conciliations entre aspirations personnelles et nécessités vitales. Vivre de son art ou de sa passion est rare mais l’on connait des artisans heureux, des gens qui aiment leur métier. Des enseignants, des tailleurs de pierre, des architectes, des agriculteurs qui savent pourquoi ils se lèvent. Des générations se succèdent dans une passion de savoir-faire, de qualité, de patrimoine. Notre besoin d’œuvre, d’être acteur du récit de notre vie est bien - encore - là.
Certes, la transformation de la société et donc du travail dès la fin du XVIIIe a vu se généraliser notamment un modèle productif industriel, celui de l’ouvrier. Il doit exécuter des taches mécaniques (un travail ?) pour gagner son pain et celui de sa famille. Accordons-lui ici que si l’image du travail-torture est un biais cognitif, son vécu en revanche n’a pas besoin d’étymologie. Et ce biais a bien servi les idéologies politiques. Peut-on penser le travail-œuvre dans l’appel à produire toujours plus ? Avec le développement exponentiel des techniques, le concept philosophico-politique de « Progrès » s’est glissée dans le sens de l’Histoire, réduisant de fait le sens intime et personnel. En effet, le « Progrès » ne nous a pas émancipé du travail, et il ne nous a pas (re)donné la nourriture. Il a produit du confort et des possibilités de consommations contre du travail. Il nous a massifié, globalisé, il nous a contraint à « travailler » toujours plus.
Le développement historique des sociétés humaines est bien sous nos yeux, du paléolithique à la 5G. Il faut travailler : avoir un métier, un emploi, un poste..., de quoi gagner de l’argent pour vivre. On trouve ainsi des équilibres ou des conciliations entre aspirations personnelles et nécessités vitales. Vivre de son art ou de sa passion est rare mais l’on connait des artisans heureux, des gens qui aiment leur métier. Des enseignants, des tailleurs de pierre, des architectes, des agriculteurs qui savent pourquoi ils se lèvent. Des générations se succèdent dans une passion de savoir-faire, de qualité, de patrimoine. Notre besoin d’œuvre, d’être acteur du récit de notre vie est bien - encore - là.
Certes, la transformation de la société et donc du travail dès la fin du XVIIIe a vu se généraliser notamment un modèle productif industriel, celui de l’ouvrier. Il doit exécuter des taches mécaniques (un travail ?) pour gagner son pain et celui de sa famille. Accordons-lui ici que si l’image du travail-torture est un biais cognitif, son vécu en revanche n’a pas besoin d’étymologie. Et ce biais a bien servi les idéologies politiques. Peut-on penser le travail-œuvre dans l’appel à produire toujours plus ? Avec le développement exponentiel des techniques, le concept philosophico-politique de « Progrès » s’est glissée dans le sens de l’Histoire, réduisant de fait le sens intime et personnel. En effet, le « Progrès » ne nous a pas émancipé du travail, et il ne nous a pas (re)donné la nourriture. Il a produit du confort et des possibilités de consommations contre du travail. Il nous a massifié, globalisé, il nous a contraint à « travailler » toujours plus.
"L’individu se retrouve seul avec son plaisir. Même son loisir se disloque : les plages sont en feu, la neige ne tombe plus."
Quand l’heure de la retraite - du Progrès - sonne...
L’après deuxième guerre mondiale, c’est la promesse des Trente glorieuses, promesse d’un monde définitivement tourné vers l’abondance, la sécurité, la consommation. C’est une paix globale et raisonnable pour tous ceux qui veulent produire/consommer/profiter. C’est la paix qui devait contaminer toute la planète puisque, pour certains, la démocratie serait fille du développement économique. C’est le rêve d’un progrès général et continu, de la médecine, des sciences au progrès social et politique en passant par la formation, les loisirs, le sexe, les voyages, et tout ce qui se consomme. Dans ce monde développé, travaille-t-on pour soi ou pour l’économie de plus en plus globale ? Pour l’œuvre de chacun, de tous ? Les vocations existent toujours et avec un peu de chance, ou d’études, le travail peut nous plaire, un temps. Et le sens se perd. Le Jardin est loin. En fait de progrès, le dernier bouleversement, c’est l’informatique, internet, les réseaux, le smartphone... soit la numérisation du monde que nous produisons sans cesse : notre propre codage hors-sol dans une nature abandonnée.
Il y a pourtant eu des signes, mais le mythe d’une croissance infinie s’est enkysté dans les esprits. Sans parler des guerres, la crise de 1929, le choc pétrolier de 1974 n’étaient pourtant pas des catastrophes naturelles... La crise est devenue le régime habituel de l’économie. En quelques décennies, le Progrès s’effondre, tout seul, devant un Jardin en friche, à l’abandon et dont personne ne s’occupe. L’individu se retrouve seul avec son plaisir. Même son loisir se disloque : les plages sont en feu, la neige ne tombe plus. D’où l’impératif de travailler encore plus pour tenter de maintenir une économie qui détruit le Jardin. Le progrès économique n’était donc pas l’Œuvre collective. Le travail que l’on croyait intéressant, diplôme de management ou d’ingénieur en poche, n’était donc pas notre travail, notre œuvre. Juste une activité pour se nourrir, produire et consommer.
Il y a pourtant eu des signes, mais le mythe d’une croissance infinie s’est enkysté dans les esprits. Sans parler des guerres, la crise de 1929, le choc pétrolier de 1974 n’étaient pourtant pas des catastrophes naturelles... La crise est devenue le régime habituel de l’économie. En quelques décennies, le Progrès s’effondre, tout seul, devant un Jardin en friche, à l’abandon et dont personne ne s’occupe. L’individu se retrouve seul avec son plaisir. Même son loisir se disloque : les plages sont en feu, la neige ne tombe plus. D’où l’impératif de travailler encore plus pour tenter de maintenir une économie qui détruit le Jardin. Le progrès économique n’était donc pas l’Œuvre collective. Le travail que l’on croyait intéressant, diplôme de management ou d’ingénieur en poche, n’était donc pas notre travail, notre œuvre. Juste une activité pour se nourrir, produire et consommer.
« La retraite n’est pas un salaire universel. »
Notre moment franco-français fait coïncider tous les débats. Celui des retraites, du sens du travail, de la nature et volume du travail et donc de l’immigration, de la formation. Celui de nos vulnérabilités liées à notre santé, liées aux dépendances économiques mondiales et à la sécurité internationale, celui de nos ressources énergétiques... bref, tout en même temps. Nous le savons, « il n’y a pas de hasard, que des rencontres ».
Le salaire universel ou la retraite heureuse ?
La retraite n’est pas un salaire universel. Elle n’est pas la nourriture donnée, ni une récompense d’enfant sage. A travers l’histoire : retraite des marins militaires (XVIIe) puis celle des fonctionnaires (XIXe) puis celle du secteur privé (XXe), la question de la retraite est celle des relations familiales, humaines, et de notre projection individualiste. C’est celle de la prise en charge d’un travail accompli, de l’âge, de la vieillesse et des ressources pour vivre dignement. Le temps de la ferme familiale où se côtoyaient de façon solidaire trois ou quatre générations est largement révolu. Comme celui des hospices - pour miséreux - des congrégations religieuses.
En France, la solidarité est devenue nationale en 1945 avec le fameux régime par répartition de la Sécurité sociale. L’État, ou disons la Nation, est devenue la « pension de famille » qui prend en charge ceux qui ont travaillé et ont droit à terminer leur vie dignement. « J’ai travaillé, j’ai cotisé, j’ai des droits ». Avec le progrès économique, un certain « troisième âge » relativement aisé est même devenu le méta-persona marketing du consumérisme silver. Mais le « Progrès » sonne à la porte et nous dit qu’avec la mondialisation, le climat, les pandémies, le conflit planétaire larvé... il faut travailler plus. Travailler, quand l’avenir s’effondre ?
En France, la solidarité est devenue nationale en 1945 avec le fameux régime par répartition de la Sécurité sociale. L’État, ou disons la Nation, est devenue la « pension de famille » qui prend en charge ceux qui ont travaillé et ont droit à terminer leur vie dignement. « J’ai travaillé, j’ai cotisé, j’ai des droits ». Avec le progrès économique, un certain « troisième âge » relativement aisé est même devenu le méta-persona marketing du consumérisme silver. Mais le « Progrès » sonne à la porte et nous dit qu’avec la mondialisation, le climat, les pandémies, le conflit planétaire larvé... il faut travailler plus. Travailler, quand l’avenir s’effondre ?
L’urgence de tout relier : travail, retraite, sens...
Nous l’avons bien compris, le Jardin d’Eden n’est pas une métaphore. Qu’importe la qualification des textes anciens, Genèse, mythes, archétypes... le Jardin est donc bien la Planète, un paradis naturel à travailler pour qui sait le voir. Création ou évolution : quelle importance face aux réalités ? Matérialisme ou religion, l’avenir est définitivement collectif.
A la question de savoir si l’être humain peut se contenter d’assurer ses besoins alimentaires et vitaux nous savons que non. Le besoin de relations est tout aussi vital. Le salaire universel ne peut être une réponse anthropologique à la question du travail. La retraite n’est pas un salaire universel, elle est le prolongement de ce travail qui reste notre œuvre.
Derrière le sens du travail, la réforme des retraites, il est sans doute urgent de se retrouver, de retrouver notre œuvre et l’œuvre collective, de regarder au-delà du confort consommable de la modernité, et de retrouver le plaisir, la joie pour ne pas dire le bonheur, d’avoir servi à quelque chose, d’avoir été utile à quelques-uns.
1 Nicholson G.G. Français travailler, travail. In : Romania, tome 53 n°209-210, 1927. pp. 206-213;
https://www.persee.fr/doc/roma_0035-8029_1927_num_53_209_4295
2 Merci à Jean Ferrat.
Bertrand-Marie Flourez, essayiste et chercheur indépendant est l'auteur de "Notre conscience nous appartient" paru chez VA Éditions.
A la question de savoir si l’être humain peut se contenter d’assurer ses besoins alimentaires et vitaux nous savons que non. Le besoin de relations est tout aussi vital. Le salaire universel ne peut être une réponse anthropologique à la question du travail. La retraite n’est pas un salaire universel, elle est le prolongement de ce travail qui reste notre œuvre.
Derrière le sens du travail, la réforme des retraites, il est sans doute urgent de se retrouver, de retrouver notre œuvre et l’œuvre collective, de regarder au-delà du confort consommable de la modernité, et de retrouver le plaisir, la joie pour ne pas dire le bonheur, d’avoir servi à quelque chose, d’avoir été utile à quelques-uns.
1 Nicholson G.G. Français travailler, travail. In : Romania, tome 53 n°209-210, 1927. pp. 206-213;
https://www.persee.fr/doc/roma_0035-8029_1927_num_53_209_4295
2 Merci à Jean Ferrat.
Bertrand-Marie Flourez, essayiste et chercheur indépendant est l'auteur de "Notre conscience nous appartient" paru chez VA Éditions.






















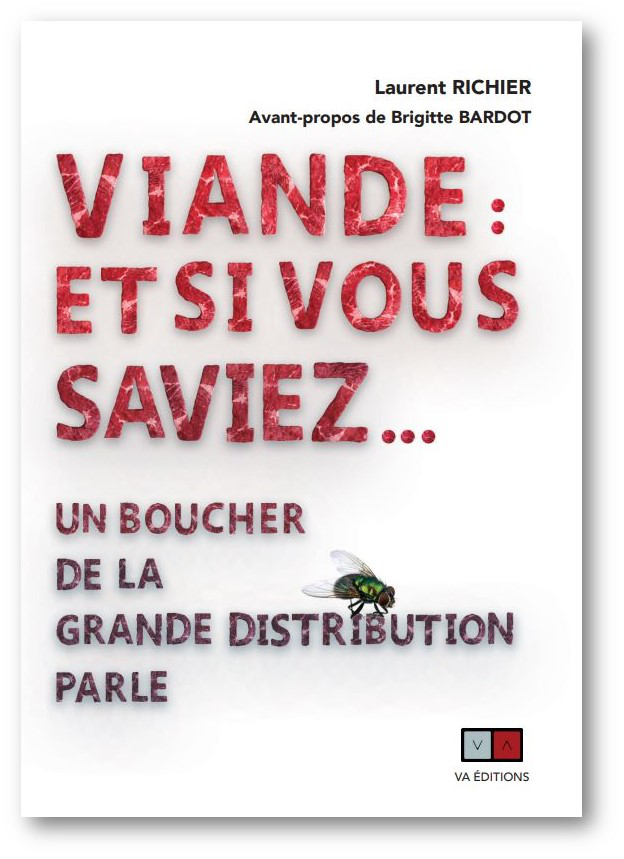

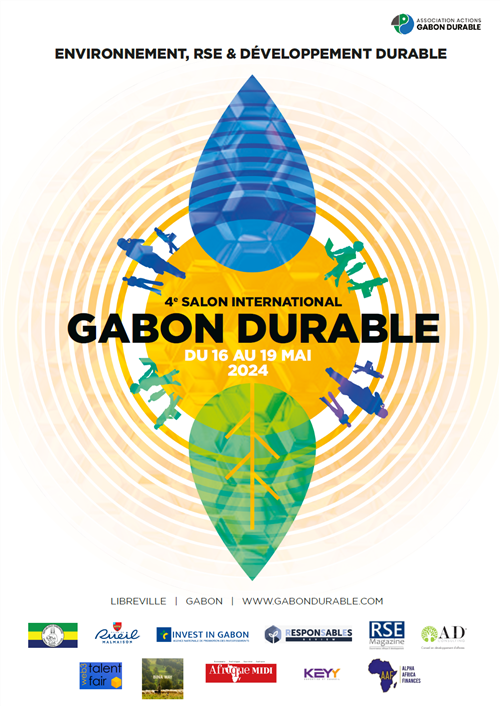
 Contacter la rédaction
Contacter la rédaction