Un enjeu de santé publique : réalités et traitement social des maladies mentales
Derrière le sens péjoratif que recouvre souvent le terme de « maladie mentale », se cache une réalité à laquelle chacun d’entre nous est exposé, directement ou indirectement, au moins une fois dans sa vie. Car le siège de la maladie (le système nerveux central) abrite des maux dont chacun comprend le sens, mais n’en cerne pas forcément les réalités. Prenons l’exemple de la dépression ; en France on recensait en 1996 sept fois plus de personnes déprimées qu’en 1970. La prégnance de la maladie au niveau européen s’élève à 27% de la population. D’après l’avis du Dr Benedetto Saraceno, directeur du département de santé mentale de l’OMS, elle devrait devenir la deuxième cause de mortalité et de handicap d’ici 2020. On recense déjà un suicide toutes les 40 minutes.
Car ces maladies sont silencieuses, mais violentes ; pour le patient, comme pour ses proches. Leurs évolutions sont souvent insidieuses, et parfois dramatiques. La vague de suicides liés au travail que connaît la France depuis maintenant plusieurs mois en témoigne. Marie-Laure Pochon, Présidente de Lundbeck France, accordait récemment une interview au Club des Managers. Elle y confiait que les maladies mentales que combat son laboratoire sont « terribles, car elles laissent des patients fragilisés, elles créent des vulnérabilités, des dé-sociabilisations ». Et pour cause : elles brisent les liens auxquels se raccroche le malade : son travail, sa famille. En négligeant l’investissement en matière de recherche, on inflige donc au patient la double peine : la maladie, puis l’isolement. Et puisqu’on ne le rappelle jamais assez, Marie-Laure Pochon insiste sur le fait que même dix ans après avoir souffert d’une dépression, on se sent encore vulnérable (résultat d’une enquête menée par Lundbeck auprès de 500 patients dépressifs).
Car ces maladies sont silencieuses, mais violentes ; pour le patient, comme pour ses proches. Leurs évolutions sont souvent insidieuses, et parfois dramatiques. La vague de suicides liés au travail que connaît la France depuis maintenant plusieurs mois en témoigne. Marie-Laure Pochon, Présidente de Lundbeck France, accordait récemment une interview au Club des Managers. Elle y confiait que les maladies mentales que combat son laboratoire sont « terribles, car elles laissent des patients fragilisés, elles créent des vulnérabilités, des dé-sociabilisations ». Et pour cause : elles brisent les liens auxquels se raccroche le malade : son travail, sa famille. En négligeant l’investissement en matière de recherche, on inflige donc au patient la double peine : la maladie, puis l’isolement. Et puisqu’on ne le rappelle jamais assez, Marie-Laure Pochon insiste sur le fait que même dix ans après avoir souffert d’une dépression, on se sent encore vulnérable (résultat d’une enquête menée par Lundbeck auprès de 500 patients dépressifs).

CC / Crashmaster007
Il faut pallier aux insuffisances de l’investissement public
La situation est alarmante, et les pouvoirs publics la mésestiment peut-être. Des chiffres éloquents sont rapportés par la Fondation de Recherches et de Soins en Santé Mentale (Fondamental / enquête IPSOS 2009) : 62% des Français craignent d’être atteints un jour de maladie mentale. Pourtant, ils sont 76% à ne pas se sentir suffisamment informés par les pouvoirs publics. Plus éloquent encore : 90% d’entre eux estiment que la recherche sur les maladies mentales doit constituer une priorité en matière de santé publique. Notons qu’au-delà des enjeux humains, ces maladies engendrent un coût pharaonique pour la collectivité, selon une autre étude commandée par la fondation FondaMental. En effet, leur coût total annuel pour la collectivité (coûts de prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, auquel on ajoute la perte de productivité et celle de qualité de vie), s’élève à 107,7 Md€. Soit 5,7% de notre PIB ! Mais le budget de la recherche sur les maladies mentales ne représente que 2% du budget total. Alors les patients sont-ils sacrifiés sur l’autel du profit, le traitement des maladies mentales n’étant pas assez rentable ? Tous ces chiffres nous confrontent à une évidence : la France enregistre un double déficit. Un déficit de financement de la recherche sur les maladies mentales, d’abord. Ensuite, un déficit d’information et de mobilisation des acteurs de la santé.
Et l’éthique, dans tout ça ?
Il faut impérativement que les acteurs privés, pour pallier à l’insuffisance de l’investissement public, se mobilisent et raisonnent en termes d’enjeux humains plutôt qu’en termes de rentabilité ou de budget. Les initiatives existent, et montrent qu’il est possible de fédérer les acteurs autour de cet enjeu de société. Par exemple, le Canada a récemment, à travers l’ICCSM (Initiative Canadienne de Collaboration en Santé Mentale, 2006), mis en place un large consortium de 12 organismes nationaux. Celui-ci représente collégialement les consommateurs, leurs familles, les soignants, la communauté et les fournisseurs de soins de santé, dans le but d’améliorer la qualité des soins de santé mentale. Son objectif, outre la collecte de fonds : améliorer le partage d’information, et la qualité des traitements. Il faut impérativement décloisonner la recherche, fédérer les acteurs, les sortir de leur isolement pour contribuer à briser celui des patients.
Autre exemple déjà cité, celui atypique du laboratoire Lundbeck France, qui se distingue de ses homologues en s’investissant d’une mission d’accompagnement des malades sur la durée. Son action dépasse ainsi la simple dimension médicamenteuse. Le mot d’ordre du laboratoire dirigé par Marie-Laure Pochon est « responsabilité », ce qui signifie aux yeux de cette dernière : améliorer les thérapeutiques, certes, mais aussi améliorer la qualité de vie et la prise en charge globale des patients. C’est dans cette optique que Lundbeck renforce ses activités de R&D en France, et multiplie les études cliniques et médico-économiques. Un « Institut Lundbeck France » a d’ailleurs vu le jour, récemment. Il fédère chaque année, autour d’une thématique, des acteurs de la santé venus d’horizons divers (médecins, personnalités politiques, économistes…). Cette volonté de rassemblement est dictée par l’impératif que rappelle Marie-Laure Pochon : « réduire l’impact de ces maladies ». Et si Lundbeck France est un laboratoire engagé, peut-être est-ce du à sa spécificité : 65% de ses capitaux sont détenus par une fondation, dont la vocation est d’octroyer des bourses pour développer la recherche sur le système nerveux central. Les résultats sont là : 23% du CA de la société est réinjecté dans la R&D. Peu d’entreprises supporteraient la comparaison.
La fondation FondaMental également martèle infatigablement que ces maladies sont l’affaire de tous. Sa Présidente, Marie-Anne Montchamp, écrivait : « l’importance des conséquences socio-économiques des maladies mentales est aujourd’hui clairement démontrée. On ne peut continuer à sous-évaluer cet enjeu majeur pour la santé publique. La fondation rappelle donc que la santé mentale concerne aussi les décideurs et les entreprises. Elle développe d’ailleurs des outils de formation au profit de ces dernières, mais aussi au profit des familles des patients, encore mal informées et trop souvent livrées à elles-mêmes.
En conclusion, le traitement des maladies mentales ne se limite pas aux traitements médicamenteux des symptômes. Il fait aussi appel à la responsabilité sociale des pouvoirs publics et des laboratoires. Comme le rappelle Marie-Laure Pochon dans son interview, cette responsabilité est « d’apporter plus que des médicaments : aider à la prise en charge », car « le médicament est utile, mais le médicament n’est pas tout ». Et compte tenu des statistiques, il est urgent qu’on y prête une oreille attentive.
Ludovic Mahi
Autre exemple déjà cité, celui atypique du laboratoire Lundbeck France, qui se distingue de ses homologues en s’investissant d’une mission d’accompagnement des malades sur la durée. Son action dépasse ainsi la simple dimension médicamenteuse. Le mot d’ordre du laboratoire dirigé par Marie-Laure Pochon est « responsabilité », ce qui signifie aux yeux de cette dernière : améliorer les thérapeutiques, certes, mais aussi améliorer la qualité de vie et la prise en charge globale des patients. C’est dans cette optique que Lundbeck renforce ses activités de R&D en France, et multiplie les études cliniques et médico-économiques. Un « Institut Lundbeck France » a d’ailleurs vu le jour, récemment. Il fédère chaque année, autour d’une thématique, des acteurs de la santé venus d’horizons divers (médecins, personnalités politiques, économistes…). Cette volonté de rassemblement est dictée par l’impératif que rappelle Marie-Laure Pochon : « réduire l’impact de ces maladies ». Et si Lundbeck France est un laboratoire engagé, peut-être est-ce du à sa spécificité : 65% de ses capitaux sont détenus par une fondation, dont la vocation est d’octroyer des bourses pour développer la recherche sur le système nerveux central. Les résultats sont là : 23% du CA de la société est réinjecté dans la R&D. Peu d’entreprises supporteraient la comparaison.
La fondation FondaMental également martèle infatigablement que ces maladies sont l’affaire de tous. Sa Présidente, Marie-Anne Montchamp, écrivait : « l’importance des conséquences socio-économiques des maladies mentales est aujourd’hui clairement démontrée. On ne peut continuer à sous-évaluer cet enjeu majeur pour la santé publique. La fondation rappelle donc que la santé mentale concerne aussi les décideurs et les entreprises. Elle développe d’ailleurs des outils de formation au profit de ces dernières, mais aussi au profit des familles des patients, encore mal informées et trop souvent livrées à elles-mêmes.
En conclusion, le traitement des maladies mentales ne se limite pas aux traitements médicamenteux des symptômes. Il fait aussi appel à la responsabilité sociale des pouvoirs publics et des laboratoires. Comme le rappelle Marie-Laure Pochon dans son interview, cette responsabilité est « d’apporter plus que des médicaments : aider à la prise en charge », car « le médicament est utile, mais le médicament n’est pas tout ». Et compte tenu des statistiques, il est urgent qu’on y prête une oreille attentive.
Ludovic Mahi
Références :
http://schwann.free.fr/neuropathologie.html (les maladies liées au système nerveux central)
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2002/mag0503/ps_5482_depression_siecle.htm (dossier dépression)
http://www.maladiesmentales.org/ (ressources)
http://www.fondation-fondamental.org/fichiers/CP_090604_final_100118-integre.pdf (Statistiques)
http://www.ccmhi.ca/fr/ (Initiative canadienne de collaboration en santé mentale)
http://www.clubdesmanagers.fr/ThemeManager.php (interview de Marie-Laure Pochon)
http://www.fondation-fondamental.org/interieur.php?page=24 (Fondation FondaMental)
http://schwann.free.fr/neuropathologie.html (les maladies liées au système nerveux central)
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2002/mag0503/ps_5482_depression_siecle.htm (dossier dépression)
http://www.maladiesmentales.org/ (ressources)
http://www.fondation-fondamental.org/fichiers/CP_090604_final_100118-integre.pdf (Statistiques)
http://www.ccmhi.ca/fr/ (Initiative canadienne de collaboration en santé mentale)
http://www.clubdesmanagers.fr/ThemeManager.php (interview de Marie-Laure Pochon)
http://www.fondation-fondamental.org/interieur.php?page=24 (Fondation FondaMental)


















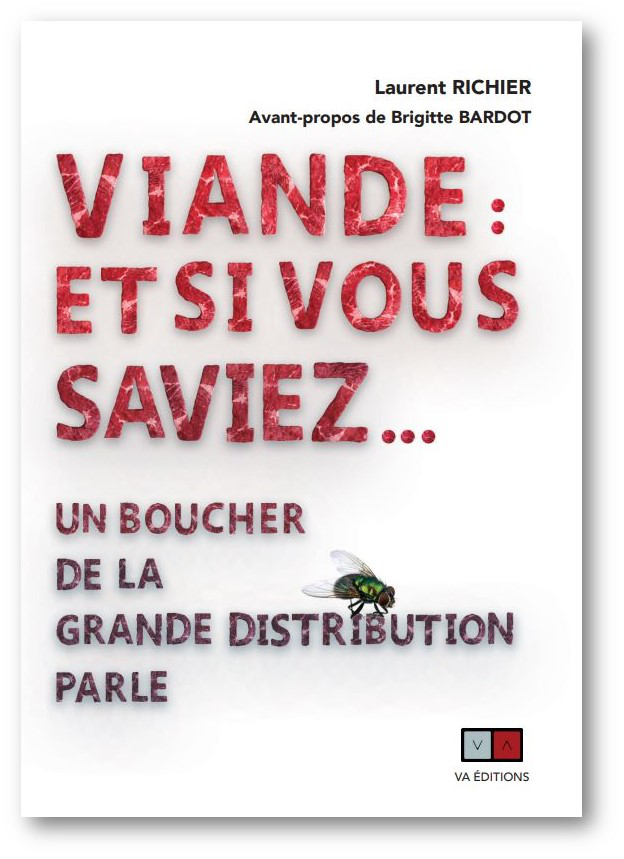

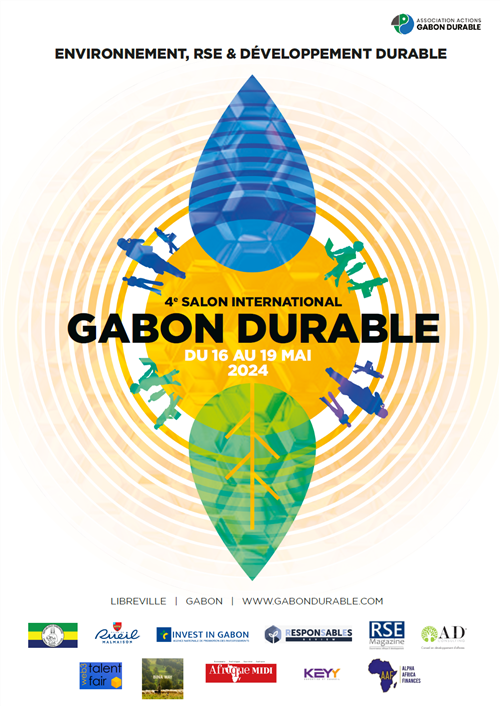
 Contacter la rédaction
Contacter la rédaction